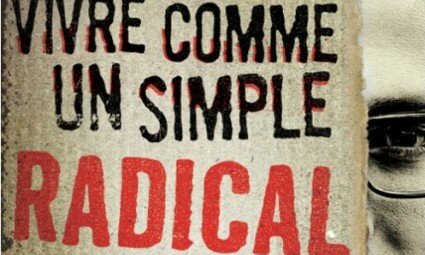Parler du « mariage pour tous » en Afrique, est-ce possible et souhaitable ?
Initialement, cet article a été rédigé suite à une commande pour une publication missiologique. Jugé trop peu conventionnel, il a ensuite été recalibré pour une page d’opinion dans la revue Evangile et liberté – que nous remercions ici! En voici la version longue, celle qui était prévue initialement.
Parler du « mariage pour tous » en Afrique, est-ce possible et souhaitable ?
L’auteure, docteure en théologie, est aussi permanente pour une association missionnaire soutenue par les organismes missionnaires français et suisses. Personnellement investie depuis des années dans le champ de la théologie féministe, progressiste et inclusive, elle nous partage ici les échanges culturels et théologiques en lien avec le « mariage pour tous » et les nouvelles formes de conjugalité qu’elle a pu avoir lors de ses séjours et rencontres.
Un contexte politique et sociétal intense
Dès son arrivée au pouvoir en mai 2012, le président François Hollande a réaffirmé son intention de tenir l’une de ses promesses de campagne, la n°31. Cette promesse de campagne visait l’égalité des droits au mariage républicain pour les couples de même genre et l’ouverture à l’adoption pour ces derniers. À peine réaffirmée, la volonté de concrétiser cette promesse a provoqué un tollé en France. Un rejet a majoritairement été exprimé par des mouvements et des groupes enracinés dans une vie de foi et une pratique religieuse structurées par le respect de la tradition et de l’ordre traditionnel du mariage et de la famille. Les autres pays francophones, notamment en Afrique, ont suivi de près les diverses manifestations, qu’elles soient pour ou contre, qu’elles soient respectueuses ou injurieuses via la télévision par satellite ou internet. De nombreux articles sont parus dans la presse étrangère et les journalistes, peu habitués à certaines terminologies et à certains aspects de la très controversée « culture gay », ont parfois fait circuler des contre-sens voire des inepties.
Représenter la pluralité du protestantisme français en temps de « crise sociétale »
C’est dans ce climat que je suis allée pour la première fois à Madagascar, en avril 2013, dans le cadre de l’association missionnaire pour laquelle je travaille, la Centrale de Littérature Chrétienne Francophone. Cette mission œuvre depuis 35 ans auprès d’une centaine de centres de formation biblique et théologique en Afrique, dans le Pacifique et la Caraïbe, pour veiller à ce que les bibliothèques soient régulièrement approvisionnées et mises à jour.
Alors engagée à mi-temps dans cette mission, je finalisais ma thèse de théologie pratique portant sur la liturgie des Eglises luthériennes et réformées en France. La possibilité de la mise en place d’une liturgie spécifique pour des bénédictions de couples de même genre dans les églises m’avait amenée, de longue date déjà, à m’informer des enjeux y afférant et à travailler avec d’autres sur ces questions épineuses et pourtant bien réelles. Un colloque sera prochainement consacré aux nouvelles conjugalités, dans le cadre des facultés de théologie de Strasbourg, les 23 et 24 mars 2017.
Cette double casquette, celle de chercheuse spécialisée sur le sujet et celle de permanente pour une association missionnaire axée sur le savoir éclairé via la formation et les livres, m’ont souvent exposée à des échanges que beaucoup fuiraient naturellement de par leur complexité.
Bien avant de partir, les nombreux pasteurs et théologiens autour de moi m’ont mise en garde : « Fais bien attention, déjà que tu es une jeune femme blanche, ne parle pas de cela en Afrique, les gens voient les choses autrement là-bas. » D’autres collègues se sont légitimement inquiétés des rapports missionnaires : « N’oublie pas que là-bas, tu représentes les missions françaises et suisses. Si tes paroles blessent nos partenaires, c’est toute la dynamique que tu grippes. »
Une posture « juste » à trouver
Une seule collègue, une jeune mère de famille comme moi, m’a sidérée en me racontant comment elle avait, alors qu’elle était en Haïti, très simplement expliqué que les protestants de France ne voyaient pas tous les choses d’un mauvais œil. Sa façon honnête, claire et concise de formuler les opinions des uns et des autres m’a séduite, d’autant que je sentais qu’elle le faisait avec respect mais sans crainte non plus. J’ai repris à mon compte cette posture, encouragée par le pasteur qui faisait ma supervision : « Respecter tous mes partenaires mais ne pas les craindre. »
Une énorme envie d’échanger
Sans étonnement, j’ai constaté, dès mon arrivée à Madagascar en avril 2013, que tous les protestants que je croisais avaient une énorme envie de discuter de ce que les médias, chez eux, appelaient, « l’inter-lgbt du mariage homosexuel. » Comment des pécheurs pouvaient-ils envisager de se marier ? Allaient-ils pouvoir acheter des enfants ? Des enfants malgaches ? Et pourquoi les femmes lesbiennes se promènent-elles les seins nus ? Et enfin : Les mariages normaux allaient-ils être interdits ?
Dans ma position de chercheuse mais aussi de partenaire missionnaire, il me semblait malhonnête de ne pas répondre avec justesse à toutes ces questions, lesquelles, vous l’aurez constaté, étaient un étrange mélange d’informations diverses – les femen manifestaient seins nus à cette époque -, de mensonges – l’achat d’enfants n’allait pas être permis – mais aussi d’absurdité – qui avait pu décider de faire croire que les mariages de genre opposé allaient être interdits ?- J’ai ainsi, à chaque fois que j’en ai eu l’occasion et toujours suite à des sollicitations extérieures, répondu à ce genre de questions. La culture malgache est plutôt réservée et je dois dire que tous les échanges ont été respectueux.
Une pastorale en attente
A la fin de mon séjour dans la capitale malgache, l’un des jeunes employés dans la grande maison familiale où je logeais m’a proposé qu’on boive un verre. Discret, poli et un peu ému, il m’a demandé s’il était vrai que dans mon pays, des hommes qui s’aimaient pouvaient se marier, sans être mis au ban ou tués par leur famille. Je lui ai répondu par la positive, en soulignant que la loi n’était pas encore passée mais que je pensais que ce serait le cas. Il m’a répondu : « mais Mme Joan, vous êtes une femme de pasteur et vous parlez de tout cela calmement. Ça ne vous poserait pas de problème, personnellement, que cette loi passe ? » Je lui ai alors expliqué que j’avais été sollicitée pour réfléchir aux liturgies de bénédiction de couple de même genre à l’église et qu’effectivement, cette éventualité ne me dérangeait pas. À la fin de cet échange d’une rare intensité, plein de sourires, de silences et de regards profonds, il a pris ma main et m’a demandé de prier avec lui pour qu’un jour, il se sente enfin en sécurité, dans ce pays qu’il aimait et dans son Eglise qu’il respectait…
La cohérence ecclésiologique, d’abord
Suite à ces expériences à Madagascar, et en dépit d’un discours ambiant plutôt désapprobateur, j’ai décidé que la posture adoptée par ma collègue à Haïti était opérante pour moi aussi. Je n’allais pas avoir un double discours, un discours « chez moi » et un discours « chez eux ». C’est une question de cohérence ecclésiologique tout d’abord. L’Église du Christ est universelle et si elle ne m’appartient pas plus qu’aux autres, elle vit et se nourrit de la diversité de ses membres et de leur théologie.
Dialoguer au cœur des tempêtes ecclésiales
En mai 2015, l’EPUdF a décidé, en synode national, de permettre aux pasteurs qui le souhaitent, en accord avec les conseils presbytéraux, d’accueillir et de bénir les couples de même genre. Bien que petite, l’EPUdF est au cœur d’un vaste réseau de diplomatie ecclésiale pour plusieurs raisons, notamment la francophonie et son héritage calviniste. Cette nouvelle fut donc accueillie comme un coup de tonnerre au sein de la majorité de ses partenaires ecclésiaux, qu’ils soient français ou étrangers ; très vite, des menaces de ruptures de communion ont été exprimées.
Quelques mois plus tard, je suis partie visiter nos partenaires en Afrique de l’Ouest et j’ai eu des occasions fréquentes et riches de dialogue avec des responsables ecclésiaux, des professeurs et des théologiens issus de nos Eglises partenaires au Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire. Deux échanges m’ont particulièrement marquée. Le premier s’est déroulé au Bénin avec une docteure en théologie spécialisée dans la question du féminisme. Pasteure et femme de pasteur, elle a exprimé la lutte quotidienne que son appel impliquait dans un contexte ecclésial comme le sien. Lorsque l’accueil des personnes homosexuelles dans les Églises a été abordé, elle a naturellement fait le lien entre les discriminations liées au genre et celles liées à l’orientation sexuelle. En langage militant, cela s’appelle la convergence des luttes et venant d’une femme noire africaine, ça a été modélisé comme une attitude d’intersectionnalité[1]. Cette spontanéité à créer des ponts entre le sexisme et l’homophobie en contexte ecclésial, venant d’une docteure en théologie, pasteure africaine, m’a renforcé dans la conviction que la parole était souvent prise en otage par les hommes dans les dialogues ecclésiaux, peu au fait de discriminations qu’ils ne subissent jamais. L’importance de la diversité et de la parité des représentants ecclésiaux dans nos relations inter-ecclésiales se pose là de manière cruciale et brûlante : qui parle pour qui et qui représente qui ? En miroir, c’est la question que posent dans l’EPUdF, les opposants aux bénédictions de couple de même genre, en déclarant ne pas avoir été représentés dans le synode national.
Un lien direct avec la polygamie et l’ingérence théologique
Toujours au cours de ce voyage en novembre 2015, je me suis rendue au Togo, où j’ai été accueillie par l’un des responsables de l’Eglise Presbytérienne. Par chance, nous avions des amis en commun et la discussion en a été facilitée, nous permettant très vite d’aborder des sujets sensibles. Alors que je lui exposais le sujet du livre que je venais d’éditer chez Labor&Fides concernant l’inclusivité, il m’a écouté attentivement et m’a énoncé deux faits que j’ai trouvé très constructifs. Tout d’abord, m’a-t-il dit, cette question n’est pas taboue dans l’Eglise presbytérienne, puisqu’elle a fait l’objet d’un synode commun avec l’Eglise sœur du Ghana en 2014, qui après avoir abordé franchement la question de la bénédiction des couples de même genre, s’est prononcé contre. Ensuite, m’a-t-il fait remarquer, quand les missionnaires blancs sont venus, ils ont changé toute la conception traditionnelle du couple et de la famille, brisant parfois de larges structures familiales solidaires et basées sur la polygamie et l’échange des femmes. Encore à l’heure actuelle, l’une des injonctions données par les évêques catholiques est que le mari abandonne ses multiples femmes pour n’en garder qu’une, laissant parfois des dizaines de personnes dans une précarité sociale criante. Il conclut, avec un sourire : « En fait, vous les théologiens « blancs », vous avez tendance à arriver et à nous dicter notre conduite… vous n’avez peut-être pas tort à chaque fois mais reconnaissez au moins que c’est frustrant pour nous africains. » Ces remarques concernant d’une part les perceptions fausses sur les Eglises africaines, dont on dit qu’elles n’abordent pas ces questions et d’autre part l’ingérence théologique post-colonialiste encore en cours sont à prendre en compte car elles me semblent légitimes et stimulantes.
Parler d’homosexualité, en Afrique et en contexte d’enseignement
Une partie de mon travail consistait à réfléchir en atelier avec les futurs pasteurs et pasteures sur les sources du savoir biblique et théologique, la pluralité théologique et l’usage possible des différents ouvrages selon leur statut (pour une prédication, un travail biblique, la catéchèse…) Je leur présentais brièvement neuf ouvrages très différents les uns des autres, destinés par ailleurs à garnir leur panier théologique suite à cet atelier (une fiche de commande individuelle était prévue à cet effet). Chacun était invité à prendre l’un ou l’autre ouvrage, à en faire une lecture diagonale et à l’exposer aux autres. L’un[2] de ces ouvrages, datant de 2000, regroupait des articles de théologie pratique écrits par des praticiens francophones et occidentaux (France, Suisse et Canada). Sans que je n’interfère, l’un des étudiants a choisi de dire ce qui l’avait le plus marqué au cours de sa lecture. Il s’agissait d’un article rédigé par un professeur québécois et portant sur des rites proposés aux malades du sida dans les hôpitaux, pendant les années 1990 alors que la communauté gay était décimée et que la plupart des clercs refusaient de prendre en compte cette situation pastorale. La réaction du professeur responsable de cet Institut biblique ivoirien, par ailleurs assez éloigné dans la brousse, a été notable : « Ah, ça c’est une question délicate, ici aussi on a la maladie, allez les futurs pasteurs, réfléchissez-y ! »
Un regard transformé sur mes partenaires et une grande espérance
Ce que j’ai vécu ne saurait représenter un modèle ou résumer l’extrême diversité théologique rencontrée partout où je suis allée. Simplement, la posture que j’ai adoptée, inspirée par celle de ma collègue, m’a permis d’avoir des échanges authentiques et respectueux, tout en sachant qu’en tant qu’invitée, je ne serais jamais confrontée à une certaine âpreté du terrain. Mon regard sur mes partenaires s’est transformé et j’ai dû me rendre à l’évidence qu’internet leur donnait accès à des informations insoupçonnées jusqu’alors. J’en tire une grande espérance pour des rapports théologiques féconds, sincères, respectueux de la diversité de nos cultures respectives… et au cours desquels il semble autant possible de discuter des femen que de la polygamie, sans langue de bois ni fausse religiosité.
Il me semble même bien lointain le temps où on pouvait dire : « Cette réalité-là n’existe pas en Afrique et il est impossible d’en discuter. » Et d’après moi, cette récente et timide levée de tabou concernant les situations de vie affectives et sexuelles ne peut que renforcer les partenariats Sud-Nord pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Réjouissons-nous !
Joan Charras-Sancho, février 2016
[2] Muriel Schmid, « Queer theology ? De quoi parle-t-on ? », in : L’accueil radical : ressources pour une Eglise inclusive, Yvan Bouquin et Joan Charras Sancho (éd.), Genève, Labor&Fides, 2015, p. 69-84.
L’intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que le racisme, le sexisme, l’homophobie ou encore les rapports de domination entre catégories sociales ne peuvent pas être entièrement expliqués s’ils sont étudiés séparément les uns des autres. L’intersectionnalité entreprend donc d’étudier les intersections entre ces différents phénomènes, comme l’a fait spontanément la théologienne rencontrée au Bénin.
[2] Bernard Kaempf (éd.), Rites et ritualités, Paris, Le Cerf – Lumen Vitae – Novalis, 2000.